Actuellement les réseaux transportant la voix, les données informatiques et la vidéo sont séparés. La demande de bande passante pour transporter les données informatiques est de plus en plus importante.
Le RNIS (Numeris) permet de transporter la voix, la vidéo (semi-animée) et les données à des vitesses relativement faibles (64 kbit/s). Ce service est commuté et occupe les réseau pendant toute la durée de la communication, c'est ce qu'on appelle une technique plesiochrone (STM : Synchronous Transfert Mode )
Au cours des années 80 le CNET de Lannion (Jean Pierre COUDREUSE) a proposé une méthode permettant d'intégrer une communication Multimédia avec une bande passante importante. Cette méthode, ATM (Asynchronous Transfert Mode) ou TTA (Transmission Temporelle Asynchrone) a été normalisée par l'ISO et le CCITT en 1989.
En ce qui concerne les données informatiques, il faut envoyer un maximum d'informations en un temps très court, cela est traditionnellement réalisé en augmentant la taille des paquets en fonction de la masse d'informations à transporter.
En effet, plus le paquet est grand, plus le temps, généralement fixe, nécessaire à la détermination du chemin à parcourir dans le réseau devient négligeable par rapport au temps de transfert du paquet. Il résulte de cette technique un temps de transmission optimisé mais variable (fonction de la taille du paquet).
En revanche les données représentant la voix ou la vidéo nécessitent un temps de transmission constant et une bande passante garantie.
Ces deux types de contraintes sont incompatibles car sur un réseau classique avec des paquets de taille variable, un paquet transportant de la voix ou de la vidéo placé derrière un grand paquet transportant des données informatiques, ne pourra se voir garantir un délai d'acheminement et l'information (voix, vidéo) sera déformée et tronquée;
Il
faut donc trouver une méthode qui combine les avantages de la commutation
de circuits (temps de transfert constant et bande passante garantie) avec
les avantages de la commutation de paquets (souplesse et prise en compte
optimisée d'un trafic intermittent)..
2. Principe de fonctionnement.
ATM intervient au niveau de la couche 2 (mode overlay) du modèle OSI (liaison);
Cette technique consiste à transporter de tout petits paquets de 53 octets appelés cellules. Ces cellules comportent en fait 48 octets de données plus 5 octets d'en-tête, ces paquets sont de longueur constante, ils passent par des nœuds de commutation rapide et les temps de transport des cellules d'un bout à l'autre du réseau sera pratiquement constant.
Comme dans la commutation de paquets X25 on définit des circuits virtuels dans lesquels l'acheminement des cellules sera effectué de façon logique par les commutateurs en lisant l'en-tête. Vu de l'utilisateur ces circuits apparaîtront comme des circuits commutés.
Les circuits virtuels (virtual channel, VC) sont établis pendant la phase de connexion entre les commutateurs ATM (pas directement entre les correspondants), ils pourront donc être partagés avec d’autres communications.
Un circuit virtuel est repéré par 2 identifiants :
· Numéro de canal vituel (Virtual Channel Identifier, VCI), il permet d’acheminer individuellement les cellules.
· Numéro de conduit virtuel (Virtual Path Identifier, VPI), il suppote plusieurs canaux virtuels.
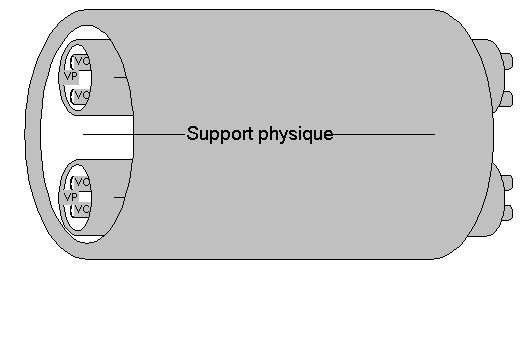
Cette technique se rapproche donc du mode de communication synchrone ce qui est satisfaisant pour la communication de la voix et de la vidéo.
Les cellules ATM sont remplies à l'émission par l'information arrivant de façon asynchrone depuis les applications. Les cellules ne sont envoyées qu'à la demande des applications on alloue dynamiquement, selon la bande passante disponible, les différents débits nécessaires.
Le
temps de commutation est très bref par rapport au temps de propagation.
Exemple : pour un
débit de 1 Mbit/s il faut 424 µs pour émettre une cellule
de 53 octets (424 bits). Les nœuds de commutation permettent de commuter
cette cellule en 10 µs. Sur un réseau de fibre optique il
faut environ 1 ms pour propager cette cellule sur 250 km ce qui est bien
supérieur au temps de commutation.
Un nœud de commutation est un simple PABX qui en entrée analyse l'information pour savoir vers quelle sortie l'orienter.
Les cellules ATM sont reçues dans leur ordre d'émission. Il peut y avoir des erreurs de transmission car le CRC ne protège que l'en-tête et pas les informations. Il faut donc une correction au niveau des couches supérieures. Les procédures de contrôle de flux ne sont pas encore totalement définies (décembre 1994).
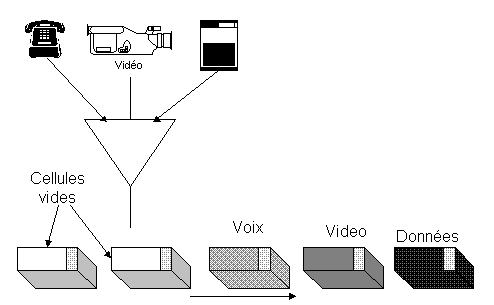
Afin de préserver
les exigences des différents flux (voix, vidéo, données),
ATM prévoit différentes classes de services, qui font l’objet
d’un contrat à la demande de connexion :
CBR : Constant Bit Rate, simule un circuit et permet de transférer de la voix non compressée.
VBR : Variable Bit Rate, permet de transporter des applications générant un flux irrégulier, VBR-RT (Real Time) s’applique aux flux nécessitant des contraintes temporelles alors que VBR-NRT n’apporte pas cette garantie.
ABR : Availlable Bit Rate, pas de garantie de débit mais apporte des informations sur l’état de charge du réseau permettant à l’émetteur de moduler son trafic.
UBR
: Unknown Bit Rate, pas de garantie de débit.
2.1 Pourquoi
48 octets ?
Le chiffre de 48 octets est un compromis entre les européens qui souhaitaient 32 octets et les américains qui en souhaitaient 64.
En effet l'information la plus difficile à prendre en compte est la parole. Techniquement, à l'émission un codeur/décodeur transforme un signal analogique en numérique à raison d'un octet toutes les 125 µs (la parole nécessite une bande passante de 4000 Hz, le théorème de Shannon impose une fréquence de 8000 Hz soit une période de 125 µs). A la réception un équipement identique réalise l'opération en sens inverse.
Pour remplir la cellule de 48 octets à raison d'un octet toutes les 125 µs, il faut environ 6 ms soit au total 12 ms pour remplir et vider la cellule. Pour le temps de transfert de la parole une norme CCITT recommande une valeur inférieure à 28 ms, en prenant 12 ms pour la conversion analogique/numérique, il ne reste plus que 16 ms pour le transport. Sur un support métallique comme le cuivre ceci correspond à une distance de 3200 km (à 200 000 km/s). Au delà les communications subissent un certain nombre de dégradations (distorsions, echo).
Les européens souhaitaient 32 octets pour disposer d'un temps de propagation plus grand car les pays étant petits (inférieur à 3000 km) , ils ne sont pas équipés d'infrastructure pour , par exemple, supprimer les échos.
Les
américains en revanche auraient préféré 64
octets afin d'être moins pénalisés par les 5 octets
d'en-tête. Le temps de propagation ayant une moindre importance aux
USA car le pays est immense et il est déjà équipé
de matériels pour prendre en compte tous les phénomènes
d'échos et autres.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 La
couche physique
ATM appartenant à la couche 2 du modèle de référence OSI il est donc indépendant du support de transmission mais est pleinement efficace sur les réseaux de fibres optiques. Au niveau de la couche physique, il est nécessaire d'utiliser un protocole qui décrit précisément comment les cellules vont être émises sur le médium. Plusieurs solutions sont envisageables. La plus couramment utilisée se nomme SONET (Synchronous Optical Network) ou son équivalent en Europe SDH (Synchronous Digital Hierarchy) .
Le principe consiste à faire transiter en permanence, toutes les 125 µs, une trame (un bloc de paquets parfaitement défini et de longueur constante) entre deux nœuds de commutation. Schématiquement, ceci correspond à un train qui circule en permanence entre deux gares, une cellule ATM peut monter dans ce train à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit de ce train.
SONET est une recommandation de l’ANSI et a déjà été adoptée par la téléphonie américaine pour la gestion de ses réseaux et adaptée pour recevoir ATM. L’ITU (ex CCITT) a normalisé la hiérarchie SDH.
SONET
exploite aussi les différentes vitesses pour le support optique
:
OC-1(Optical Carrier) 51,84 Mbits/s
OC-3 155,52 Mbits/s (3 x 51,84)
OC-12
622,08 Mbits/s (12 x 51,84)
Ces vitesses ne sont limitées que par la technique des interfaces, on envisage déjà les vitesse
OC-24, 36 ou 48, soit 1,24, 1,86 et 2,5 Gbits/s.
La génération existante aujourd'hui (1993) est dite plésiochrone. La vitesse de base est de 2 Mbits/s (E1) suivie par des vitesses multiples de celle-ci soit 34 (E3) et 140 Mbits/s (E4). C'est l'offre actuelle (1993) de France Télécom et des autres PTT européennes.
Les
nouveaux matériels de transmission qui arrivent depuis peu (1993)
aux USA sont basés sur la technique SONET ou SDH avec des débits
de 155 Mbits/s puis 622 Mbits/s…
2.3 Perspectives
(Janvier 94)
Pour France Télécom l'introduction de produits SDH correspondent aux besoins du réseau de communication interurbain des grands commutateurs régionaux. Le réseau de distribution ne sera pas sous cette technique avant longtemps.
On prévoit d'installer une prise ATM dans les foyers vers 2010, mais cette technique intéresse surtout les opérateurs du câble pour le multimédia.
Cette technique s'applique aux interconnexions d'ordinateurs et également aux besoins vidéo. Cette dernière catégorie apparaît comme l'une de plus prometteuses car elle est déjà très demandée pour la visioconférence.
Actuellement (1994) Alcatel dispose déjà de "chips" ATM à 620 Mbits/s.
Le
RNIS se trouvant au niveau 3 profitera naturellement des améliorations
en vitesse qu'apportera ATM.
2.4 Déploiement
d'ATM
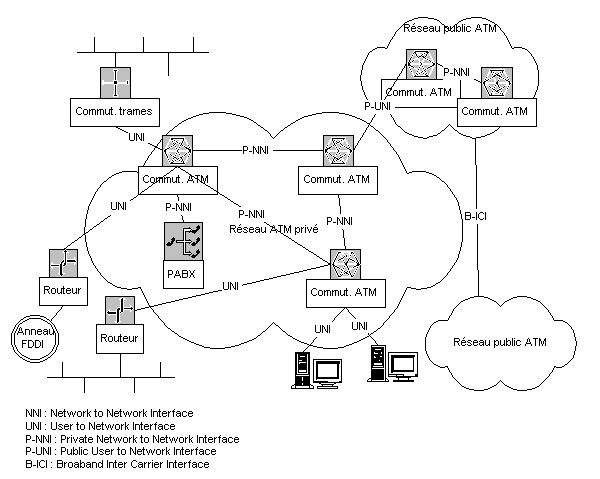 .
.
3. ATM et
les réseaux locaux existants.
Bien qu’ATM permette la connexion directe de stations de travail et de serveurs cela nécessite le changement des cartes d’interface et peut-être de la topologie du réseau. Pour préserver l’investissement fait dans les réseaux locaux (70 millions de noeuds Ethernet installés dans le monde) le forum ATM a défini un protocole d’émulation de réseaux locaux (LAN Emulation - LANE) dont “ Le principal objectif consiste à permettre aux applications existantes d’accéder à un réseau ATM via les piles de protocoles APPN, NetBIOS, IPx, etc ..., comme si elles s’exécutaient sur un réseau local traditionnel ”.
Il existe des différences fondamentales entre les réseaux locaux ATM et les réseaux locaux à support partagé (Ethernet, Token Ring, FDDI, ... ) :
· Les réseaux locaux classiques utilisent la diffusion générale (broadcast) alors qu’ATM ne permet que des connexions point à point ou point à multipoint.
· ATM étant vu par les applications comme un réseau de commutation “ réseau à plat ”, les broadcasts simulés sont envoyés à toutes les connexions (pas de limitation par domaine de broadcast).
· ATM supporte plusieurs qualités de service, les protocoles de réseau actuels n’en supportent pas, mais les nouveaux protocoles (IPV6) les supporteront, il faudra alors établir une correspondance avec les qualités de service disponibles sur ATM.
3.1 Lan
Emulation : LANE
Afin de protéger les investissements des utilisateurs au niveau des applications et des logiciels réseau, et pour rendre le support ATM utilisable par les protocoles existants, ATM va devoir se comporter comme un réseau local classique grâce à LANE.
Du
point de vue conceptuel LANE offre une couche de traduction entre les couches
hautes s’appuyant sur un service sans connexion et la couche basse ATM
qui nécessite l’établissement d’une connexion avant toute
communication.
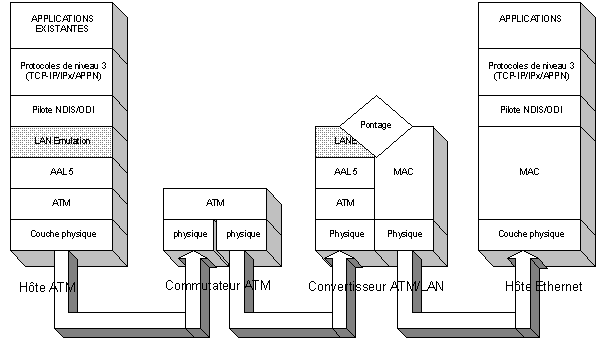
La couche ATM est directement au dessus de la couche physique, l’indépendance du support est un principe fondamental d’ATM. La couche ATM gère les en-têtes des cellules ATM qui sont de longueur fixe. Elle reçoit, des couches supérieures, les informations à mettre dans les cellules, elle ajoute l’en-tête et passe les cellules résultantes (53 octets) à la couche physique. En réception elle reçoit les cellules de la couche physique, extrait l’en-tête, et passe les 48 bits restants aux couches supérieures. La couche ATM n’a pas connaissance du type de trafic qu’elle transporte, cependant elle doit distinguer les qualités de service grâce aux informations acquises pendant la phase de connexion.
La couche d’adaptation ATM (ATM Adaptation Layer - AAL) découpe les données en “ morceaux ” de 48 bits afin de pouvoir les “ charger ” dans les cellules ( cette opération s’appelle la segmentation). Lorsque les cellules ATM atteignent leur destination, on reconstruit les données pour les couches supérieures, ce processus s’appelle réassemblage.
Comme ATM doit pouvoir transmettre différents types de trafic, il existe, au niveau de la couche adaptation, plusieurs protocoles, chacun travaillant simultanément. C’est l’AAL de type 5 qui est utilisée pour l’émulation de réseau local, LANE est donc au dessus de AAL5. Dans un convertisseur LAN/ATM, LANE résout les problèmes pour tous les protocoles (routables ou non routables) en traduisant les adresses LAN en adresses ATM au niveau de la couche MAC. LANE est totalement indépendant des protocoles des couches supérieures, des services et des applications.
LANE est entièrement transparent pour les réseaux ATM et pour les hôtes Ethernet ou Token Ring. LANE masque complètement l’établissement de la connexion et les fonctions de prise de contact (handshaking) nécessaires aux commutateurs ATM.
LANE
traduit les communications entre noeuds ayant une adresse MAC (réseaux
locaux classiques) en communications sur des circuits virtuels ATM. Le
réseau ATM apparaît alors comme un réseau sans connexion
(pour les couches supérieures).
3.1.1 Les composants
fonctionnels de LANE.
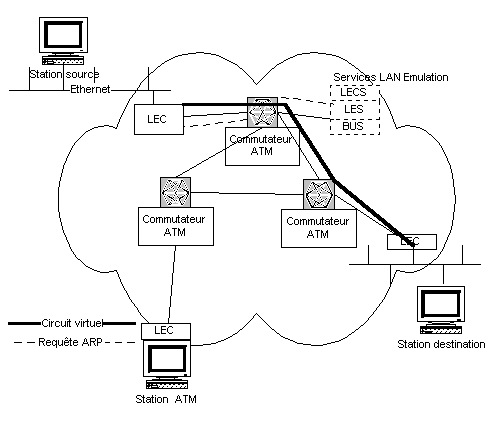
· Le LES contrôle le réseau et gère la traduction d’adresses MAC en adresses ATM.
· Le BUS est conçu pour transmettre les paquets de diffusion (broadcast) comme les paquets ARP de TCP/IP. Il gère également tout le trafic multi-destination (multicast). Pendant la phase transitoire il diffuse (broadcast) les premiers paquets adressés à une seule station (unicast) envoyés par le LEC (Lan Emulation Client) pendant que le LES cherche à obtenir l’adresse ATM de la station destinataire afin d’établir un circuit virtuel direct entre la source et la destination.
· Le LECS (Lan Emulation Configuration Serveur) doit affecter dynamiquement les différents LECs aux différents LAN émulés (ELAN). Il indique au client (LEC) l’adresse ATM du LES dont il dépend. Il peut affecter un LEC à un LAN émulé (ELAN) soit sur la base de sa position physique (adresse ATM du LEC) soit grâce à une association logique.
1. Des connexions de commande qui transportent des messages administratifs tels que les informations nécessaires à la configuration initiale ou les adresses des autres LECs.
2. Des connexions transportant les données de toutes les autres communications. Elles permettent, en particulier, les liaisons point à point entre clients et les liaisons entre clients et BUS pour les messages de diffusion générale et multipoints.
3.1.2 Les LANs
émulés.
Un client LANE obtient la traduction des adresses MAC en adresses ATM grâce aux fonctions du serveur. Chaque client est connecté à un serveur par une connexion virtuelle. Seuls les clients connectés au même serveur peuvent communiquer entre eux : ils appartiennent au même LAN émulé.
EXEMPLE
:
Vue
physique :
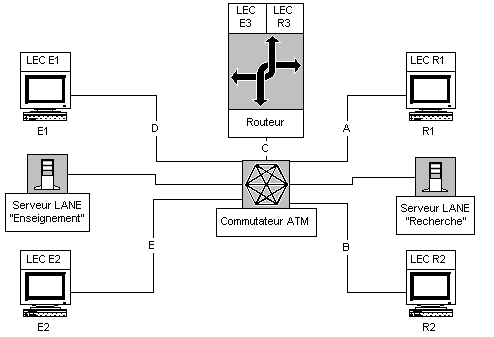
Base
de données du serveur “ enseignement ”
| Adresse MAC | Adresse ATM |
| E1 | D |
| E2 | E |
| E3 | C |
Base
de données du serveur “ recherche ”
| Adresse MAC | Adresse ATM |
| R1 | A |
| R2 | B |
| R3 | C |
Quand
le client “ recherche ” R1 veut envoyer un paquet au client “ enseignement
” E1, le serveur “ recherche ” cherche E1 dans sa base. Il ne le trouve
pas, alors il renvoie l’adresse du routeur E3/R3 qui à son tour
renvoie le paquet au serveur “ enseignement ” pour transmission à
E1 (le paquet traverse 2 fois le commutateur ATM).
Vue logique :
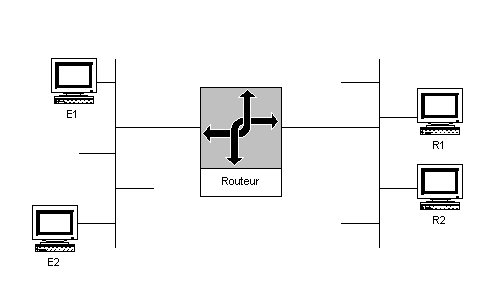
3.1.3 Exemple fonctionnel détaillé.
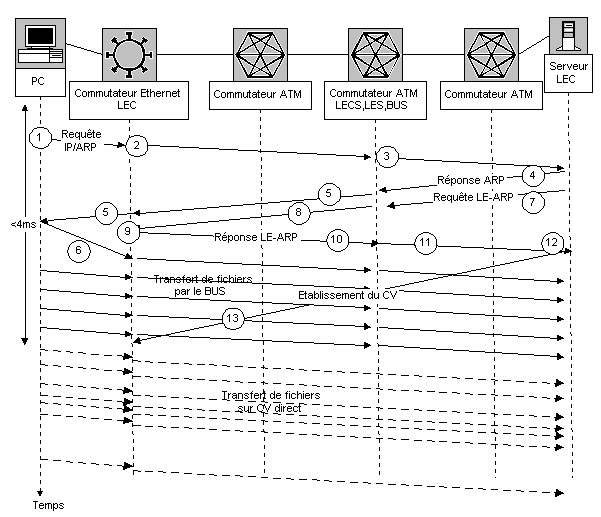
1. Le logiciel réseau du PC doit localiser le serveur. Pour déterminer l’adresse MAC du serveur le PC envoie une requête ARP (Address Resolution Protocol) en broadcast (Ethernet) contenant l’adresse IP du serveur avec lequel il veut communiquer (procédure classique sur les réseaux Ethernet/IP).
2. La requête ARP atteint le commutateur Ethernet/ATM, son LEC transmet ce paquet broadcast au BUS.
3. Le BUS envoie la requête ARP à tous les noeuds du LAN émulé sur un circuit virtuel point à multipoint (CV).
4. Le LEC du serveur reçoit la requête ARP et reconnaît sa propre adresse IP. En réponse il envoie son adresse MAC dans un paquet ARP vers l’adresse MAC du PC demandeur. Il n’y a pas encore de circuit virtuel vers le commutateur Ethernet/ATM sur lequel est connecté le PC, alors le LEC du serveur envoie la réponse ARP au BUS. Simultanément il commence a créer un circuit virtuel vers le commutateur Ethernet ATM (comme décrit à l’étape 7).
5. Le BUS retransmet (par simulation de broadcast) la réponse ARP au commutateur Ethernet/ATM, qui la transmet à son tour au PC.
6. Maintenant le PC connaît l’adresse MAC du serveur et peut commencer à échanger des paquets avec le serveur, pour cela il utilse les services du BUS.
7. Pendant ce temps le LEC du serveur crée un circuit virtuel direct vers le commutateur Ethernet/ATM : il commence par envoyer une requête LE-ARP au LES pour demander l’adresse ATM correspondant à l’adresse MAC du PC (l’adresse MAC du PC à été obtenue à partir de la requête ARP de l’étape 4).
8. Le LES ne peut pas trouver l’adresse MAC du PC dans sa table de référence car le PC est “ masqué ” par le commutateur Ethernet/ATM. Le LES va donc envoyer la requête LE-ARP en multicast à tous les LECs.
9. Le LEC du commutateur Ethernet/ATM reçoit la requête LE-ARP et reconnaît l’adresse MAC du PC (il a pris connaissance de l’adresse MAC du PC lorsqu’il a du gérer le broadcast ARP de l’étape 2).
10. Le LEC du commutateur Ethernet/ATM renvoie sa propre adresse ATM dans une réponse LE-ARP et la renvoie au LES.
11. Le LES renvoie par multicast la réponse LE-ARP à tous les membres du LAN émulé.
12. Le LEC du serveur reçoit la réponse LE-ARP, il extrait l’adresse ATM du commutateur Ethernet/ATM et demande l’établissement d’un circuit virtuel direct (CV) vers celui-ci.
13. La dorsale ATM établit un CV direct entre le serveur et le commutateur Ethernet/ATM.
14. Les échanges entre le serveur et le PC s’effectuent maintenant directement (CV).
Le modèle est restreint au transport du protocole IP et simplifie donc les procédures LAN Emulation qui ont une vocation multi protocole.
Classical IP est basé sur des sous-réseaux logiques IP (LIS - Logical IP Subnet) supportés par des circuits virtuels commutés (CVC). Un LIS est un ensemble de Noeuds IP connectés à un réseau ATM (ces noeuds appartiennent au même sous-réseau IP [subnet]).
Pour établir un CVC chaque station doit connaître l’adresse ATM du destinataire IP qu’elle cherche à joindre. L’obtention de cette adresse s’appuie sur un serveur désigné ATM-ARP (ATM Address Resolution Protocol) capable de traduire (en adresse ATM) les adresses des membres IP appartenant à un même LIS (on ne peut pas utiliser de broadcast ARP sur ATM). Tous les logiciels classical IP ont bien entendu en mémoire l’adresse ATM du serveur ATM-ARP dont ils relèvent. Les LIS portent la même adresse ATM que leur serveur.
A chaque connexion d’un circuit virtuel le serveur ATM-ARP met à jour sa table de correspondance en lançant vers le client une requête I-ATM-ARP (Inverse ATM-ARP) pour obtenir l’adresse IP (à partir d’une adresse ATM). L’adresse ATM est considérée comme une adresse matérielle au même titre que les adresses MAC (Ethernet). Lorsque les circuits virtuels sont établis le paquet IP est intégré à la PDU AAL5 CPCS (Common Part Convergence Sub-layer).
Comparé au service LANE, classical IP se révèle très économe en ressources mais il est monoprotocolaire. Classical IP ne prend pas en compte les critères de qualité de service (il utilise des connexions UBR ou ABR). D’autre part l’organisation en sous réseaux IP (LIS) impose de “ remonter ” au niveau 3 (routeur) pour passer d’un sous-réseau à un autre ce qui occasionne un goulot d’étranglement sur l’infrastructure ATM (les routeurs doivent posséder une interface ATM et le logiciel classical IP), le délai de transit devient alors proportionnel au nombre de LIS traversés. Pour éviter cet inconvénient l’IETF propose une solution appelée NHRP (Next Hop Resolution Protocol. Cette solution repose sur un serveur de routes appelé NHS (Next Hop Server) qui convertit les données de routage IP de l’émetteur en adresse ATM du destinataire, une fois cette conversion réalisée les datagrammes transitent directement sur un circuit virtuel ATM sans aucun traitement de routage intermédiaire.
NHRP présente des points faibles dans la prise en compte du trafic broadcast et multicast, là encore l’IETF propose une solution à l’aide du protocole MARS (Multicast Address Resolution Server).
Comparaison des modèles LAN Emulation et Classical IP :
3.3 Multi Protocol Over ATM (MPOA).
MPOA permet une connexion directe, à travers un réseau ATM, entre des noeuds ATM et/ou des noeuds classiques résidents sur des sous-réseaux (subnet) distincts.
La spécification MPOA a été approuvée en juillet 1997, elle vise à optimiser l’exploitation des circuits ATM (commutation) tout en conservant la fonction de routage multi-protocole.
MPOA s’inspire largement du protocole classical IP. Il utilise le routage “ zéro saut ” NHRP (Next Hop Resolution Protocol) et la gestion du trafic MARS (Multicast Address Resolution Server) de l’IETF. Il cohabite avec les protocoles de routage traditionnels comme RIP et OSPF.
L’architecture MPOA applique la commutation ATM à tous les protocoles de routage en diminuant notablement les temps de transit. Après avoir identifié le destinataire, l’émetteur établit un circuit virtuel d’une seule traite sans avoir à “ remonter ” au niveau 3 à chaque traversée de routeur pour obtenir la route suivante (MPOA supprime les “ sauts de puce ” imposés par les routages traditionnels.
MPOA autorise l’emploi de MTU (Maximum Transfer Unit) de taille variable pour optimiser le débit et prend en compte certains critères de qualité de service ATM.
L
‘architecture MPOA se base sur la notion de routeur virtuel, compromis
entre les routeurs traditionnels et les commutateurs de niveau 3. Le routeur
virtuel détermine le chemin optimal entre les réseaux
virtuels, on l’appelle, par abus de langage, serveur de routes. Le
routeur virtuel intègre les protocoles de routage traditionnels,
gère les trafics broadcast et multicast, il réalise les résolutions
d’adresses des commutateurs restées sans réponse. Ce routeur
virtuel a pour bus un ensemble de commutateurs ATM. Cette architecture
élimine le goulot d’étranglement introduit par les routeurs
classiques.
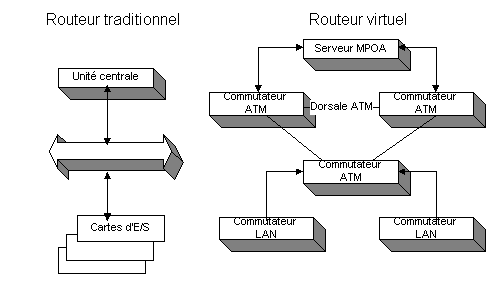
Dans la pratique cette architecture est réalisée par 2 unités logiques opérant en mode client/serveur :
· Unité d’accès MPOA (client): C’est une station ATM ou commutateur LAN de niveau 3 qui héberge un logiciel client MPOA, appelé MPC, inter-agissant avec un LEC (Lan Emulation Client) et/ou un gestionnaire de commutation de niveau 3. Cette unité est également appelée équipement d’extrémité (edge device) ou commutateur multiniveau (multi layer switch). Elle transmet les paquets entre les noeuds d’un réseau local et les noeuds ATM. Elle ne contient pas des protocole de routage, mais doit pouvoir commuter à diférents niveaux.
· Routeur MPOA (serveur) : Il est constitué d’un commutateur ATM associé à un logiciel serveur MPOA appelé MPS. Ce dernier, intégré au sein de l’équipement hôte ou opérant sur une station externe, comprend un serveur NHS (Next Hop Server) chargé de l’interconnexion avec les MPC. Le serveur MPOA dispose d’un moteur de routage conventionnel (RIP, OSPF, ...) et d’un serveur LES qui renseigne les LECSs sur l’adresse ATM des noeuds destinataires appartenant à un même réseau émulé. Le routeur MPOA doit avoir une connaissance des adresses MAC ainsi que des protocoles de la couche 3 (routage) du sous-réseau qu’il sert. Il doit également distribuer cette information à d’autres serveurs.
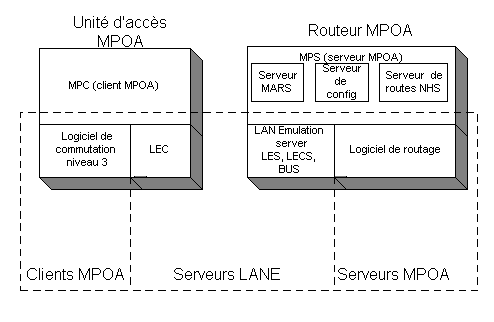
Lorsque le circuit virtuel est établi entre le demandeur et son destinataire, la transmission se résume à une simple opération de pontage. En revanche lorsque les correspondants dépendent de réseaux émulés (ELAN) distincts le LES passe la main au serveur MPOA qui joue alors le rôle d’intermédiaire.
Exemple de communication :
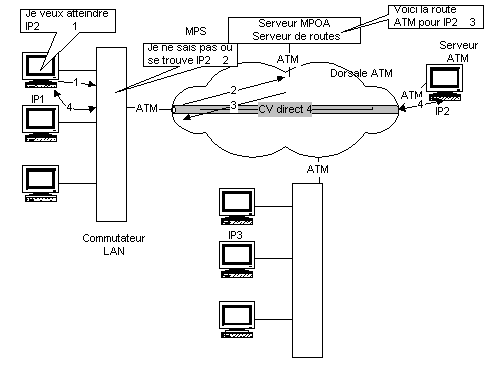
MPOA
fournit les services suivants :
n Type de protocole supporté.
n Appartenance aux ELAN
n Adresses ATM des clients MPOA.
-Transmission directe du trafic unicast vers le destinataire (procédure par défaut).
-Transmission
en utilisant les informations (concernant la couche réseau du destinataire)
déjà mémorisées.
Conclusion
:
Le modèle MPOA décrit un routeur distribué, les équipements d’extrémité (clients) assurent la commutation (retransmission) alors que le serveur de routes (serveur) établit les tables de routage et fournit les routes aux équipements d’extrémité.
Ce modèle permet aux équipements MPOA d’un sous-réseau (subnet) d’établir des connexions directes avec les équipements d’un autre sous-réseau. Cela permet les communications entre différents ELAN.
MPOA
assure l’évolutivité d’un réseau entièrement
routé tout en mettant la qualité de service à la disposition
des couches de niveau 3.
Le modèle MPOA :
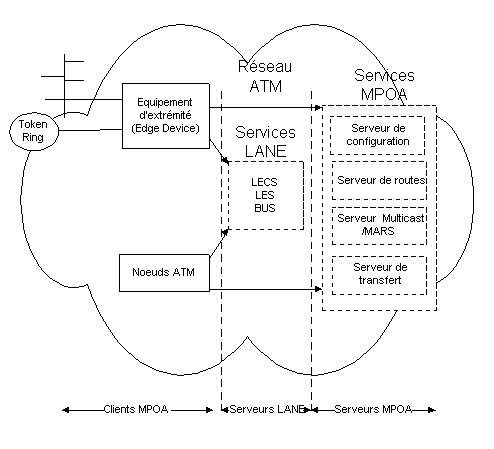
3.3.2 LAN Emulation
et MPOA.
Interactions
entre LANE et MPOA : les clients MPOA cherchent d’abord à résoudre
les adresses en utilisant les services LANE. En cas de nécessité
ils utilisent les services MPOA.
1. Communication entre 2 éléments reliés au même commutateur d’extrémité (A et B) : commutation Ethernet classique.
2. Communication intra ELAN (A et C) : Le serveur LAN Emulation (LES) de l’ELAN met en relation directe les 2 commutateurs par l’intermédiaire d’un circuit virtuel ATM (CV). Les 2 stations peuvent alors communiquer par LES interposé, comme dans un environnement Ethernet classique. En fin de communication le CV est détruit.
3. Communication inter ELAN (A et D) : Le LEC est incapable de mettre en relation les commutateurs (LEC) de 2 ELAN différents. Il établit alors, par défaut, une relation entre le commutateur de son ELAN (LEC) et le routeur. Le serveur MPOA du routeur (MPS) donne la route pour atteindre la destination et met en relation directe les 2 commutateurs d’extrémité (MPC/LEC) par l’intermédiaire d’un circuit virtuel ATM (CV). Les 2 stations communiquent par MPC interposé comme dans un environnement IP classique. En fin de communication le CV est détruit.
ATM et les
réseaux locaux
Hervé GILIBERT
Herve.Gilibert@Univ-st-etienne.fr
1.
Pourquoi ATM ?
2.
Principe de fonctionnement.
Actuellement les réseaux transportant la voix, les données informatiques et la vidéo sont séparés. La demande de bande passante pour transporter les données informatiques est de plus en plus importante.
Le RNIS (Numeris) permet de transporter la voix, la vidéo (semi-animée) et les données à des vitesses relativement faibles (64 kbit/s). Ce service est commuté et occupe les réseau pendant toute la durée de la communication, c'est ce qu'on appelle une technique plesiochrone (STM : Synchronous Transfert Mode )
Au cours des années 80 le CNET de Lannion (Jean Pierre COUDREUSE) a proposé une méthode permettant d'intégrer une communication Multimédia avec une bande passante importante. Cette méthode, ATM (Asynchronous Transfert Mode) ou TTA (Transmission Temporelle Asynchrone) a été normalisée par l'ISO et le CCITT en 1989.
En ce qui concerne les données informatiques, il faut envoyer un maximum d'informations en un temps très court, cela est traditionnellement réalisé en augmentant la taille des paquets en fonction de la masse d'informations à transporter.
En effet, plus le paquet est grand, plus le temps, généralement fixe, nécessaire à la détermination du chemin à parcourir dans le réseau devient négligeable par rapport au temps de transfert du paquet. Il résulte de cette technique un temps de transmission optimisé mais variable (fonction de la taille du paquet).
En revanche les données représentant la voix ou la vidéo nécessitent un temps de transmission constant et une bande passante garantie.
Ces deux types de contraintes sont incompatibles car sur un réseau classique avec des paquets de taille variable, un paquet transportant de la voix ou de la vidéo placé derrière un grand paquet transportant des données informatiques, ne pourra se voir garantir un délai d'acheminement et l'information (voix, vidéo) sera déformée et tronquée;
Il
faut donc trouver une méthode qui combine les avantages de la commutation
de circuits (temps de transfert constant et bande passante garantie) avec
les avantages de la commutation de paquets (souplesse et prise en compte
optimisée d'un trafic intermittent)..
2. Principe
de fonctionnement.
ATM intervient au niveau de la couche 2 (mode overlay) du modèle OSI (liaison);
Cette technique consiste à transporter de tout petits paquets de 53 octets appelés cellules. Ces cellules comportent en fait 48 octets de données plus 5 octets d'en-tête, ces paquets sont de longueur constante, ils passent par des nœuds de commutation rapide et les temps de transport des cellules d'un bout à l'autre du réseau sera pratiquement constant.
Comme dans la commutation de paquets X25 on définit des circuits virtuels dans lesquels l'acheminement des cellules sera effectué de façon logique par les commutateurs en lisant l'en-tête. Vu de l'utilisateur ces circuits apparaîtront comme des circuits commutés.
Les circuits virtuels (virtual channel, VC) sont établis pendant la phase de connexion entre les commutateurs ATM (pas directement entre les correspondants), ils pourront donc être partagés avec d’autres communications.
Un circuit virtuel est repéré par 2 identifiants :
· Numéro de canal vituel (Virtual Channel Identifier, VCI), il permet d’acheminer individuellement les cellules.
· Numéro de conduit virtuel (Virtual Path Identifier, VPI), il suppote plusieurs canaux virtuels.
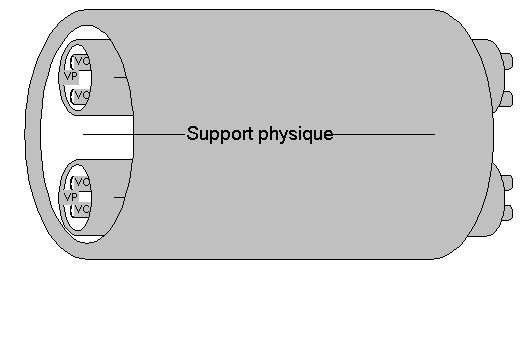
Cette technique se rapproche donc du mode de communication synchrone ce qui est satisfaisant pour la communication de la voix et de la vidéo.
Les cellules ATM sont remplies à l'émission par l'information arrivant de façon asynchrone depuis les applications. Les cellules ne sont envoyées qu'à la demande des applications on alloue dynamiquement, selon la bande passante disponible, les différents débits nécessaires.
Le
temps de commutation est très bref par rapport au temps de propagation.
Exemple
: pour un débit de 1 Mbit/s il faut 424 µs pour émettre
une cellule de 53 octets (424 bits). Les nœuds de commutation permettent
de commuter cette cellule en 10 µs. Sur un réseau de fibre
optique il faut environ 1 ms pour propager cette cellule sur 250 km ce
qui est bien supérieur au temps de commutation.
Un nœud de commutation est un simple PABX qui en entrée analyse l'information pour savoir vers quelle sortie l'orienter.
Les cellules ATM sont reçues dans leur ordre d'émission. Il peut y avoir des erreurs de transmission car le CRC ne protège que l'en-tête et pas les informations. Il faut donc une correction au niveau des couches supérieures. Les procédures de contrôle de flux ne sont pas encore totalement définies (décembre 1994).
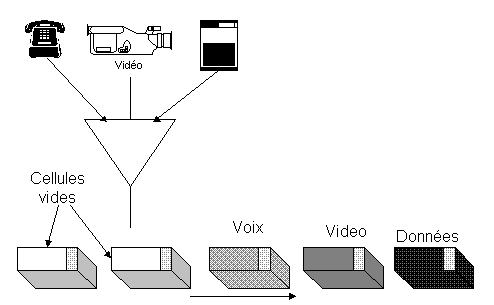
Afin
de préserver les exigences des différents flux (voix, vidéo,
données), ATM prévoit différentes classes de services,
qui font l’objet d’un contrat à la demande de connexion :
CBR : Constant Bit Rate, simule un circuit et permet de transférer de la voix non compressée.
VBR : Variable Bit Rate, permet de transporter des applications générant un flux irrégulier, VBR-RT (Real Time) s’applique aux flux nécessitant des contraintes temporelles alors que VBR-NRT n’apporte pas cette garantie.
ABR : Availlable Bit Rate, pas de garantie de débit mais apporte des informations sur l’état de charge du réseau permettant à l’émetteur de moduler son trafic.
UBR
: Unknown Bit Rate, pas de garantie de débit.
2.1 Pourquoi
48 octets ?
Le chiffre de 48 octets est un compromis entre les européens qui souhaitaient 32 octets et les américains qui en souhaitaient 64.
En effet l'information la plus difficile à prendre en compte est la parole. Techniquement, à l'émission un codeur/décodeur transforme un signal analogique en numérique à raison d'un octet toutes les 125 µs (la parole nécessite une bande passante de 4000 Hz, le théorème de Shannon impose une fréquence de 8000 Hz soit une période de 125 µs). A la réception un équipement identique réalise l'opération en sens inverse.
Pour remplir la cellule de 48 octets à raison d'un octet toutes les 125 µs, il faut environ 6 ms soit au total 12 ms pour remplir et vider la cellule. Pour le temps de transfert de la parole une norme CCITT recommande une valeur inférieure à 28 ms, en prenant 12 ms pour la conversion analogique/numérique, il ne reste plus que 16 ms pour le transport. Sur un support métallique comme le cuivre ceci correspond à une distance de 3200 km (à 200 000 km/s). Au delà les communications subissent un certain nombre de dégradations (distorsions, echo).
Les européens souhaitaient 32 octets pour disposer d'un temps de propagation plus grand car les pays étant petits (inférieur à 3000 km) , ils ne sont pas équipés d'infrastructure pour , par exemple, supprimer les échos.
Les
américains en revanche auraient préféré 64
octets afin d'être moins pénalisés par les 5 octets
d'en-tête. Le temps de propagation ayant une moindre importance aux
USA car le pays est immense et il est déjà équipé
de matériels pour prendre en compte tous les phénomènes
d'échos et autres.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 La
couche physique
ATM appartenant à la couche 2 du modèle de référence OSI il est donc indépendant du support de transmission mais est pleinement efficace sur les réseaux de fibres optiques. Au niveau de la couche physique, il est nécessaire d'utiliser un protocole qui décrit précisément comment les cellules vont être émises sur le médium. Plusieurs solutions sont envisageables. La plus couramment utilisée se nomme SONET (Synchronous Optical Network) ou son équivalent en Europe SDH (Synchronous Digital Hierarchy) .
Le principe consiste à faire transiter en permanence, toutes les 125 µs, une trame (un bloc de paquets parfaitement défini et de longueur constante) entre deux nœuds de commutation. Schématiquement, ceci correspond à un train qui circule en permanence entre deux gares, une cellule ATM peut monter dans ce train à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit de ce train.
SONET est une recommandation de l’ANSI et a déjà été adoptée par la téléphonie américaine pour la gestion de ses réseaux et adaptée pour recevoir ATM. L’ITU (ex CCITT) a normalisé la hiérarchie SDH.
SONET
exploite aussi les différentes vitesses pour le support optique
:
OC-1(Optical Carrier) 51,84 Mbits/s
OC-3 155,52 Mbits/s (3 x 51,84)
OC-12
622,08 Mbits/s (12 x 51,84)
Ces vitesses ne sont limitées que par la technique des interfaces, on envisage déjà les vitesse
OC-24, 36 ou 48, soit 1,24, 1,86 et 2,5 Gbits/s.
La génération existante aujourd'hui (1993) est dite plésiochrone. La vitesse de base est de 2 Mbits/s (E1) suivie par des vitesses multiples de celle-ci soit 34 (E3) et 140 Mbits/s (E4). C'est l'offre actuelle (1993) de France Télécom et des autres PTT européennes.
Les
nouveaux matériels de transmission qui arrivent depuis peu (1993)
aux USA sont basés sur la technique SONET ou SDH avec des débits
de 155 Mbits/s puis 622 Mbits/s…
2.3 Perspectives
(Janvier 94)
Pour France Télécom l'introduction de produits SDH correspondent aux besoins du réseau de communication interurbain des grands commutateurs régionaux. Le réseau de distribution ne sera pas sous cette technique avant longtemps.
On prévoit d'installer une prise ATM dans les foyers vers 2010, mais cette technique intéresse surtout les opérateurs du câble pour le multimédia.
Cette technique s'applique aux interconnexions d'ordinateurs et également aux besoins vidéo. Cette dernière catégorie apparaît comme l'une de plus prometteuses car elle est déjà très demandée pour la visioconférence.
Actuellement (1994) Alcatel dispose déjà de "chips" ATM à 620 Mbits/s.
Le
RNIS se trouvant au niveau 3 profitera naturellement des améliorations
en vitesse qu'apportera ATM.
2.4 Déploiement
d'ATM
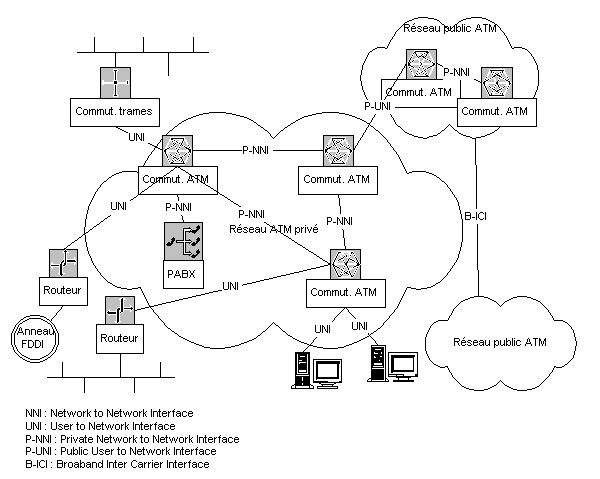 .
.
3. ATM et
les réseaux locaux existants.
Bien qu’ATM permette la connexion directe de stations de travail et de serveurs cela nécessite le changement des cartes d’interface et peut-être de la topologie du réseau. Pour préserver l’investissement fait dans les réseaux locaux (70 millions de noeuds Ethernet installés dans le monde) le forum ATM a défini un protocole d’émulation de réseaux locaux (LAN Emulation - LANE) dont “ Le principal objectif consiste à permettre aux applications existantes d’accéder à un réseau ATM via les piles de protocoles APPN, NetBIOS, IPx, etc ..., comme si elles s’exécutaient sur un réseau local traditionnel ”.
Il existe des différences fondamentales entre les réseaux locaux ATM et les réseaux locaux à support partagé (Ethernet, Token Ring, FDDI, ... ) :
· Les réseaux locaux classiques utilisent la diffusion générale (broadcast) alors qu’ATM ne permet que des connexions point à point ou point à multipoint.
· ATM étant vu par les applications comme un réseau de commutation “ réseau à plat ”, les broadcasts simulés sont envoyés à toutes les connexions (pas de limitation par domaine de broadcast).
· ATM supporte plusieurs qualités de service, les protocoles de réseau actuels n’en supportent pas, mais les nouveaux protocoles (IPV6) les supporteront, il faudra alors établir une correspondance avec les qualités de service disponibles sur ATM.
3.1 Lan
Emulation : LANE
Afin de protéger les investissements des utilisateurs au niveau des applications et des logiciels réseau, et pour rendre le support ATM utilisable par les protocoles existants, ATM va devoir se comporter comme un réseau local classique grâce à LANE.
Du
point de vue conceptuel LANE offre une couche de traduction entre les couches
hautes s’appuyant sur un service sans connexion et la couche basse ATM
qui nécessite l’établissement d’une connexion avant toute
communication.
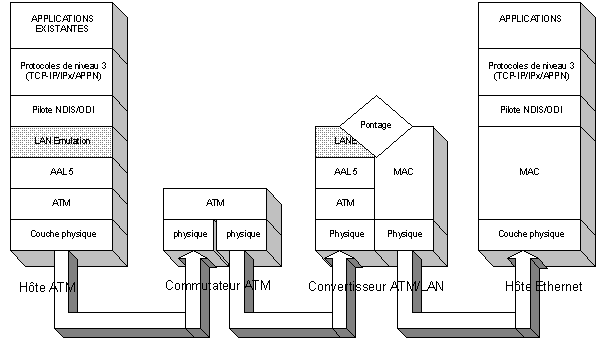
La couche ATM est directement au dessus de la couche physique, l’indépendance du support est un principe fondamental d’ATM. La couche ATM gère les en-têtes des cellules ATM qui sont de longueur fixe. Elle reçoit, des couches supérieures, les informations à mettre dans les cellules, elle ajoute l’en-tête et passe les cellules résultantes (53 octets) à la couche physique. En réception elle reçoit les cellules de la couche physique, extrait l’en-tête, et passe les 48 bits restants aux couches supérieures. La couche ATM n’a pas connaissance du type de trafic qu’elle transporte, cependant elle doit distinguer les qualités de service grâce aux informations acquises pendant la phase de connexion.
La couche d’adaptation ATM (ATM Adaptation Layer - AAL) découpe les données en “ morceaux ” de 48 bits afin de pouvoir les “ charger ” dans les cellules ( cette opération s’appelle la segmentation). Lorsque les cellules ATM atteignent leur destination, on reconstruit les données pour les couches supérieures, ce processus s’appelle réassemblage.
Comme ATM doit pouvoir transmettre différents types de trafic, il existe, au niveau de la couche adaptation, plusieurs protocoles, chacun travaillant simultanément. C’est l’AAL de type 5 qui est utilisée pour l’émulation de réseau local, LANE est donc au dessus de AAL5. Dans un convertisseur LAN/ATM, LANE résout les problèmes pour tous les protocoles (routables ou non routables) en traduisant les adresses LAN en adresses ATM au niveau de la couche MAC. LANE est totalement indépendant des protocoles des couches supérieures, des services et des applications.
LANE est entièrement transparent pour les réseaux ATM et pour les hôtes Ethernet ou Token Ring. LANE masque complètement l’établissement de la connexion et les fonctions de prise de contact (handshaking) nécessaires aux commutateurs ATM.
LANE
traduit les communications entre noeuds ayant une adresse MAC (réseaux
locaux classiques) en communications sur des circuits virtuels ATM. Le
réseau ATM apparaît alors comme un réseau sans connexion
(pour les couches supérieures).
3.1.1 Les composants
fonctionnels de LANE.
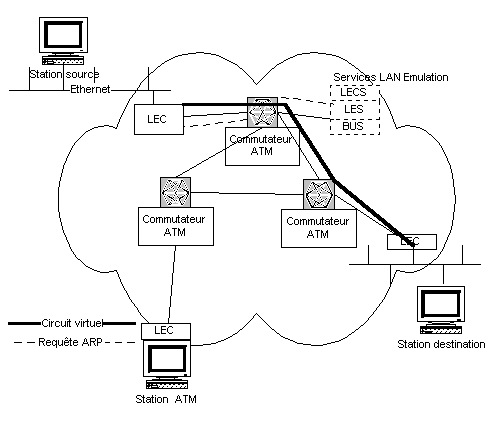
· Le LES contrôle le réseau et gère la traduction d’adresses MAC en adresses ATM.
· Le BUS est conçu pour transmettre les paquets de diffusion (broadcast) comme les paquets ARP de TCP/IP. Il gère également tout le trafic multi-destination (multicast). Pendant la phase transitoire il diffuse (broadcast) les premiers paquets adressés à une seule station (unicast) envoyés par le LEC (Lan Emulation Client) pendant que le LES cherche à obtenir l’adresse ATM de la station destinataire afin d’établir un circuit virtuel direct entre la source et la destination.
· Le LECS (Lan Emulation Configuration Serveur) doit affecter dynamiquement les différents LECs aux différents LAN émulés (ELAN). Il indique au client (LEC) l’adresse ATM du LES dont il dépend. Il peut affecter un LEC à un LAN émulé (ELAN) soit sur la base de sa position physique (adresse ATM du LEC) soit grâce à une association logique.
1. Des connexions de commande qui transportent des messages administratifs tels que les informations nécessaires à la configuration initiale ou les adresses des autres LECs.
2. Des connexions transportant les données de toutes les autres communications. Elles permettent, en particulier, les liaisons point à point entre clients et les liaisons entre clients et BUS pour les messages de diffusion générale et multipoints.
3.1.2 Les LANs
émulés.
Un client LANE obtient la traduction des adresses MAC en adresses ATM grâce aux fonctions du serveur. Chaque client est connecté à un serveur par une connexion virtuelle. Seuls les clients connectés au même serveur peuvent communiquer entre eux : ils appartiennent au même LAN émulé.
EXEMPLE
:
Vue
physique :
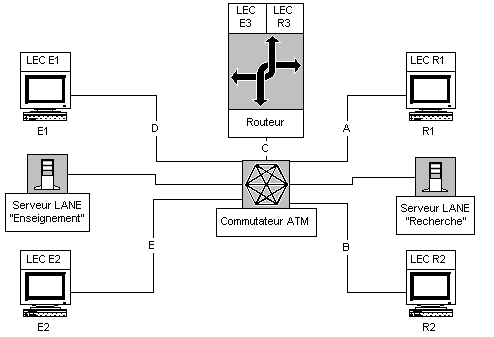
Base
de données du serveur “ enseignement ”
| Adresse MAC | Adresse ATM |
| E1 | D |
| E2 | E |
| E3 | C |
Base
de données du serveur “ recherche ”
| Adresse MAC | Adresse ATM |
| R1 | A |
| R2 | B |
| R3 | C |
Quand
le client “ recherche ” R1 veut envoyer un paquet au client “ enseignement
” E1, le serveur “ recherche ” cherche E1 dans sa base. Il ne le trouve
pas, alors il renvoie l’adresse du routeur E3/R3 qui à son tour
renvoie le paquet au serveur “ enseignement ” pour transmission à
E1 (le paquet traverse 2 fois le commutateur ATM).
Vue logique :
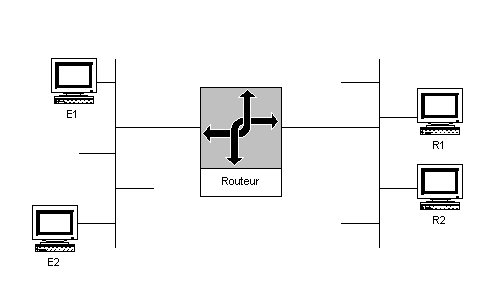
3.1.3 Exemple fonctionnel détaillé.
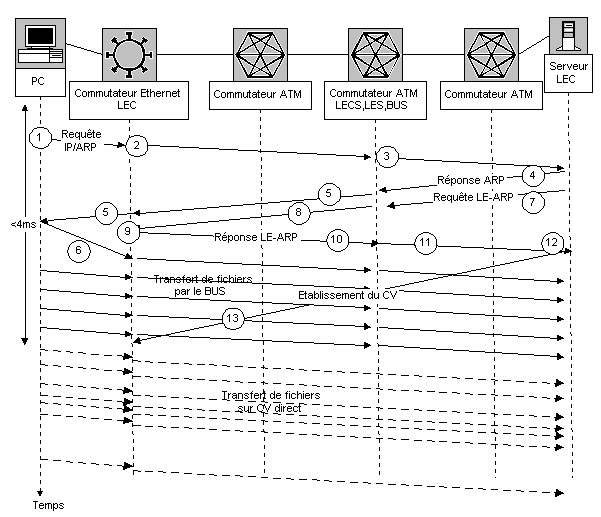
1. Le logiciel réseau du PC doit localiser le serveur. Pour déterminer l’adresse MAC du serveur le PC envoie une requête ARP (Address Resolution Protocol) en broadcast (Ethernet) contenant l’adresse IP du serveur avec lequel il veut communiquer (procédure classique sur les réseaux Ethernet/IP).
2. La requête ARP atteint le commutateur Ethernet/ATM, son LEC transmet ce paquet broadcast au BUS.
3. Le BUS envoie la requête ARP à tous les noeuds du LAN émulé sur un circuit virtuel point à multipoint (CV).
4. Le LEC du serveur reçoit la requête ARP et reconnaît sa propre adresse IP. En réponse il envoie son adresse MAC dans un paquet ARP vers l’adresse MAC du PC demandeur. Il n’y a pas encore de circuit virtuel vers le commutateur Ethernet/ATM sur lequel est connecté le PC, alors le LEC du serveur envoie la réponse ARP au BUS. Simultanément il commence a créer un circuit virtuel vers le commutateur Ethernet ATM (comme décrit à l’étape 7).
5. Le BUS retransmet (par simulation de broadcast) la réponse ARP au commutateur Ethernet/ATM, qui la transmet à son tour au PC.
6. Maintenant le PC connaît l’adresse MAC du serveur et peut commencer à échanger des paquets avec le serveur, pour cela il utilse les services du BUS.
7. Pendant ce temps le LEC du serveur crée un circuit virtuel direct vers le commutateur Ethernet/ATM : il commence par envoyer une requête LE-ARP au LES pour demander l’adresse ATM correspondant à l’adresse MAC du PC (l’adresse MAC du PC à été obtenue à partir de la requête ARP de l’étape 4).
8. Le LES ne peut pas trouver l’adresse MAC du PC dans sa table de référence car le PC est “ masqué ” par le commutateur Ethernet/ATM. Le LES va donc envoyer la requête LE-ARP en multicast à tous les LECs.
9. Le LEC du commutateur Ethernet/ATM reçoit la requête LE-ARP et reconnaît l’adresse MAC du PC (il a pris connaissance de l’adresse MAC du PC lorsqu’il a du gérer le broadcast ARP de l’étape 2).
10. Le LEC du commutateur Ethernet/ATM renvoie sa propre adresse ATM dans une réponse LE-ARP et la renvoie au LES.
11. Le LES renvoie par multicast la réponse LE-ARP à tous les membres du LAN émulé.
12. Le LEC du serveur reçoit la réponse LE-ARP, il extrait l’adresse ATM du commutateur Ethernet/ATM et demande l’établissement d’un circuit virtuel direct (CV) vers celui-ci.
13. La dorsale ATM établit un CV direct entre le serveur et le commutateur Ethernet/ATM.
14. Les échanges entre le serveur et le PC s’effectuent maintenant directement (CV).
Le modèle est restreint au transport du protocole IP et simplifie donc les procédures LAN Emulation qui ont une vocation multi protocole.
Classical IP est basé sur des sous-réseaux logiques IP (LIS - Logical IP Subnet) supportés par des circuits virtuels commutés (CVC). Un LIS est un ensemble de Noeuds IP connectés à un réseau ATM (ces noeuds appartiennent au même sous-réseau IP [subnet]).
Pour établir un CVC chaque station doit connaître l’adresse ATM du destinataire IP qu’elle cherche à joindre. L’obtention de cette adresse s’appuie sur un serveur désigné ATM-ARP (ATM Address Resolution Protocol) capable de traduire (en adresse ATM) les adresses des membres IP appartenant à un même LIS (on ne peut pas utiliser de broadcast ARP sur ATM). Tous les logiciels classical IP ont bien entendu en mémoire l’adresse ATM du serveur ATM-ARP dont ils relèvent. Les LIS portent la même adresse ATM que leur serveur.
A chaque connexion d’un circuit virtuel le serveur ATM-ARP met à jour sa table de correspondance en lançant vers le client une requête I-ATM-ARP (Inverse ATM-ARP) pour obtenir l’adresse IP (à partir d’une adresse ATM). L’adresse ATM est considérée comme une adresse matérielle au même titre que les adresses MAC (Ethernet). Lorsque les circuits virtuels sont établis le paquet IP est intégré à la PDU AAL5 CPCS (Common Part Convergence Sub-layer).
Comparé au service LANE, classical IP se révèle très économe en ressources mais il est monoprotocolaire. Classical IP ne prend pas en compte les critères de qualité de service (il utilise des connexions UBR ou ABR). D’autre part l’organisation en sous réseaux IP (LIS) impose de “ remonter ” au niveau 3 (routeur) pour passer d’un sous-réseau à un autre ce qui occasionne un goulot d’étranglement sur l’infrastructure ATM (les routeurs doivent posséder une interface ATM et le logiciel classical IP), le délai de transit devient alors proportionnel au nombre de LIS traversés. Pour éviter cet inconvénient l’IETF propose une solution appelée NHRP (Next Hop Resolution Protocol. Cette solution repose sur un serveur de routes appelé NHS (Next Hop Server) qui convertit les données de routage IP de l’émetteur en adresse ATM du destinataire, une fois cette conversion réalisée les datagrammes transitent directement sur un circuit virtuel ATM sans aucun traitement de routage intermédiaire.
NHRP présente des points faibles dans la prise en compte du trafic broadcast et multicast, là encore l’IETF propose une solution à l’aide du protocole MARS (Multicast Address Resolution Server).
Comparaison des modèles LAN Emulation et Classical IP :
3.3 Multi Protocol Over ATM (MPOA).
MPOA permet une connexion directe, à travers un réseau ATM, entre des noeuds ATM et/ou des noeuds classiques résidents sur des sous-réseaux (subnet) distincts.
La spécification MPOA a été approuvée en juillet 1997, elle vise à optimiser l’exploitation des circuits ATM (commutation) tout en conservant la fonction de routage multi-protocole.
MPOA s’inspire largement du protocole classical IP. Il utilise le routage “ zéro saut ” NHRP (Next Hop Resolution Protocol) et la gestion du trafic MARS (Multicast Address Resolution Server) de l’IETF. Il cohabite avec les protocoles de routage traditionnels comme RIP et OSPF.
L’architecture MPOA applique la commutation ATM à tous les protocoles de routage en diminuant notablement les temps de transit. Après avoir identifié le destinataire, l’émetteur établit un circuit virtuel d’une seule traite sans avoir à “ remonter ” au niveau 3 à chaque traversée de routeur pour obtenir la route suivante (MPOA supprime les “ sauts de puce ” imposés par les routages traditionnels.
MPOA autorise l’emploi de MTU (Maximum Transfer Unit) de taille variable pour optimiser le débit et prend en compte certains critères de qualité de service ATM.
L
‘architecture MPOA se base sur la notion de routeur virtuel, compromis
entre les routeurs traditionnels et les commutateurs de niveau 3. Le routeur
virtuel détermine le chemin optimal entre les réseaux
virtuels, on l’appelle, par abus de langage, serveur de routes. Le
routeur virtuel intègre les protocoles de routage traditionnels,
gère les trafics broadcast et multicast, il réalise les résolutions
d’adresses des commutateurs restées sans réponse. Ce routeur
virtuel a pour bus un ensemble de commutateurs ATM. Cette architecture
élimine le goulot d’étranglement introduit par les routeurs
classiques.
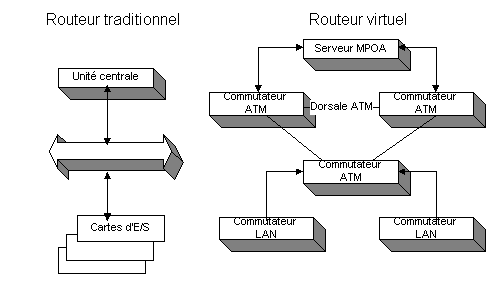
Dans la pratique cette architecture est réalisée par 2 unités logiques opérant en mode client/serveur :
· Unité d’accès MPOA (client): C’est une station ATM ou commutateur LAN de niveau 3 qui héberge un logiciel client MPOA, appelé MPC, inter-agissant avec un LEC (Lan Emulation Client) et/ou un gestionnaire de commutation de niveau 3. Cette unité est également appelée équipement d’extrémité (edge device) ou commutateur multiniveau (multi layer switch). Elle transmet les paquets entre les noeuds d’un réseau local et les noeuds ATM. Elle ne contient pas des protocole de routage, mais doit pouvoir commuter à diférents niveaux.
· Routeur MPOA (serveur) : Il est constitué d’un commutateur ATM associé à un logiciel serveur MPOA appelé MPS. Ce dernier, intégré au sein de l’équipement hôte ou opérant sur une station externe, comprend un serveur NHS (Next Hop Server) chargé de l’interconnexion avec les MPC. Le serveur MPOA dispose d’un moteur de routage conventionnel (RIP, OSPF, ...) et d’un serveur LES qui renseigne les LECSs sur l’adresse ATM des noeuds destinataires appartenant à un même réseau émulé. Le routeur MPOA doit avoir une connaissance des adresses MAC ainsi que des protocoles de la couche 3 (routage) du sous-réseau qu’il sert. Il doit également distribuer cette information à d’autres serveurs.
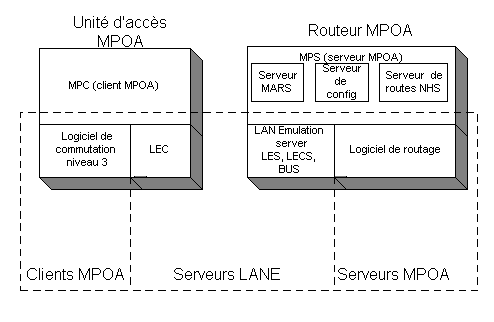
Lorsque le circuit virtuel est établi entre le demandeur et son destinataire, la transmission se résume à une simple opération de pontage. En revanche lorsque les correspondants dépendent de réseaux émulés (ELAN) distincts le LES passe la main au serveur MPOA qui joue alors le rôle d’intermédiaire.
Exemple de communication :
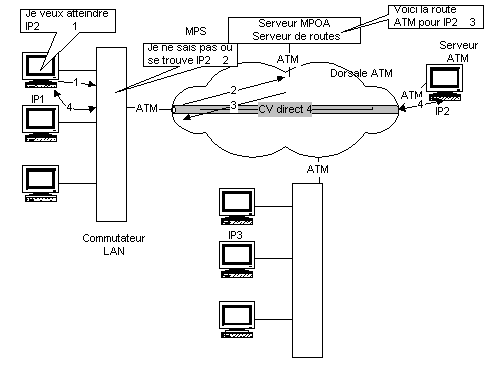
MPOA
fournit les services suivants :
n Type de protocole supporté.
n Appartenance aux ELAN
n Adresses ATM des clients MPOA.
-Transmission directe du trafic unicast vers le destinataire (procédure par défaut).
-Transmission
en utilisant les informations (concernant la couche réseau du destinataire)
déjà mémorisées.
Conclusion
:
Le modèle MPOA décrit un routeur distribué, les équipements d’extrémité (clients) assurent la commutation (retransmission) alors que le serveur de routes (serveur) établit les tables de routage et fournit les routes aux équipements d’extrémité.
Ce modèle permet aux équipements MPOA d’un sous-réseau (subnet) d’établir des connexions directes avec les équipements d’un autre sous-réseau. Cela permet les communications entre différents ELAN.
MPOA
assure l’évolutivité d’un réseau entièrement
routé tout en mettant la qualité de service à la disposition
des couches de niveau 3.
Le modèle MPOA :
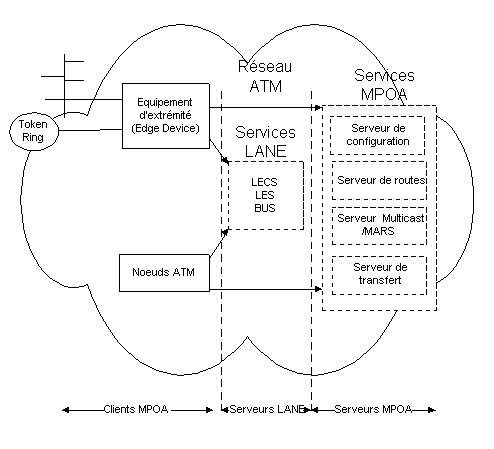
3.3.2 LAN Emulation
et MPOA.
Interactions
entre LANE et MPOA : les clients MPOA cherchent d’abord à résoudre
les adresses en utilisant les services LANE. En cas de nécessité
ils utilisent les services MPOA.
1. Communication entre 2 éléments reliés au même commutateur d’extrémité (A et B) : commutation Ethernet classique.
2. Communication intra ELAN (A et C) : Le serveur LAN Emulation (LES) de l’ELAN met en relation directe les 2 commutateurs par l’intermédiaire d’un circuit virtuel ATM (CV). Les 2 stations peuvent alors communiquer par LES interposé, comme dans un environnement Ethernet classique. En fin de communication le CV est détruit.
3. Communication inter ELAN (A et D) : Le LEC est incapable de mettre en relation les commutateurs (LEC) de 2 ELAN différents. Il établit alors, par défaut, une relation entre le commutateur de son ELAN (LEC) et le routeur. Le serveur MPOA du routeur (MPS) donne la route pour atteindre la destination et met en relation directe les 2 commutateurs d’extrémité (MPC/LEC) par l’intermédiaire d’un circuit virtuel ATM (CV). Les 2 stations communiquent par MPC interposé comme dans un environnement IP classique. En fin de communication le CV est détruit.
ATM et les
réseaux locaux
Hervé GILIBERT
Herve.Gilibert@Univ-st-etienne.fr
1.
Pourquoi ATM ?
2.
Principe de fonctionnement.
Actuellement les réseaux transportant la voix, les données informatiques et la vidéo sont séparés. La demande de bande passante pour transporter les données informatiques est de plus en plus importante.
Le RNIS (Numeris) permet de transporter la voix, la vidéo (semi-animée) et les données à des vitesses relativement faibles (64 kbit/s). Ce service est commuté et occupe les réseau pendant toute la durée de la communication, c'est ce qu'on appelle une technique plesiochrone (STM : Synchronous Transfert Mode )
Au cours des années 80 le CNET de Lannion (Jean Pierre COUDREUSE) a proposé une méthode permettant d'intégrer une communication Multimédia avec une bande passante importante. Cette méthode, ATM (Asynchronous Transfert Mode) ou TTA (Transmission Temporelle Asynchrone) a été normalisée par l'ISO et le CCITT en 1989.
En ce qui concerne les données informatiques, il faut envoyer un maximum d'informations en un temps très court, cela est traditionnellement réalisé en augmentant la taille des paquets en fonction de la masse d'informations à transporter.
En effet, plus le paquet est grand, plus le temps, généralement fixe, nécessaire à la détermination du chemin à parcourir dans le réseau devient négligeable par rapport au temps de transfert du paquet. Il résulte de cette technique un temps de transmission optimisé mais variable (fonction de la taille du paquet).
En revanche les données représentant la voix ou la vidéo nécessitent un temps de transmission constant et une bande passante garantie.
Ces deux types de contraintes sont incompatibles car sur un réseau classique avec des paquets de taille variable, un paquet transportant de la voix ou de la vidéo placé derrière un grand paquet transportant des données informatiques, ne pourra se voir garantir un délai d'acheminement et l'information (voix, vidéo) sera déformée et tronquée;
Il
faut donc trouver une méthode qui combine les avantages de la commutation
de circuits (temps de transfert constant et bande passante garantie) avec
les avantages de la commutation de paquets (souplesse et prise en compte
optimisée d'un trafic intermittent)..
2. Principe
de fonctionnement.
ATM intervient au niveau de la couche 2 (mode overlay) du modèle OSI (liaison);
Cette technique consiste à transporter de tout petits paquets de 53 octets appelés cellules. Ces cellules comportent en fait 48 octets de données plus 5 octets d'en-tête, ces paquets sont de longueur constante, ils passent par des nœuds de commutation rapide et les temps de transport des cellules d'un bout à l'autre du réseau sera pratiquement constant.
Comme dans la commutation de paquets X25 on définit des circuits virtuels dans lesquels l'acheminement des cellules sera effectué de façon logique par les commutateurs en lisant l'en-tête. Vu de l'utilisateur ces circuits apparaîtront comme des circuits commutés.
Les circuits virtuels (virtual channel, VC) sont établis pendant la phase de connexion entre les commutateurs ATM (pas directement entre les correspondants), ils pourront donc être partagés avec d’autres communications.
Un circuit virtuel est repéré par 2 identifiants :
· Numéro de canal vituel (Virtual Channel Identifier, VCI), il permet d’acheminer individuellement les cellules.
· Numéro de conduit virtuel (Virtual Path Identifier, VPI), il suppote plusieurs canaux virtuels.
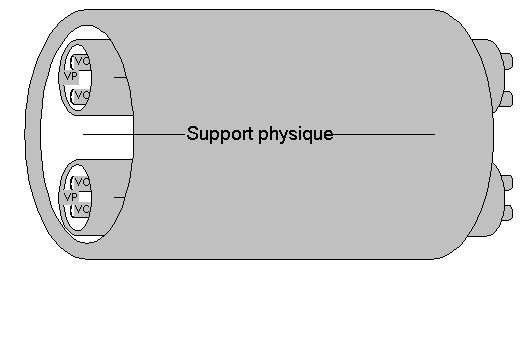
Cette technique se rapproche donc du mode de communication synchrone ce qui est satisfaisant pour la communication de la voix et de la vidéo.
Les cellules ATM sont remplies à l'émission par l'information arrivant de façon asynchrone depuis les applications. Les cellules ne sont envoyées qu'à la demande des applications on alloue dynamiquement, selon la bande passante disponible, les différents débits nécessaires.
Le
temps de commutation est très bref par rapport au temps de propagation.
Exemple
: pour un débit de 1 Mbit/s il faut 424 µs pour émettre
une cellule de 53 octets (424 bits). Les nœuds de commutation permettent
de commuter cette cellule en 10 µs. Sur un réseau de fibre
optique il faut environ 1 ms pour propager cette cellule sur 250 km ce
qui est bien supérieur au temps de commutation.
Un nœud de commutation est un simple PABX qui en entrée analyse l'information pour savoir vers quelle sortie l'orienter.
Les cellules ATM sont reçues dans leur ordre d'émission. Il peut y avoir des erreurs de transmission car le CRC ne protège que l'en-tête et pas les informations. Il faut donc une correction au niveau des couches supérieures. Les procédures de contrôle de flux ne sont pas encore totalement définies (décembre 1994).
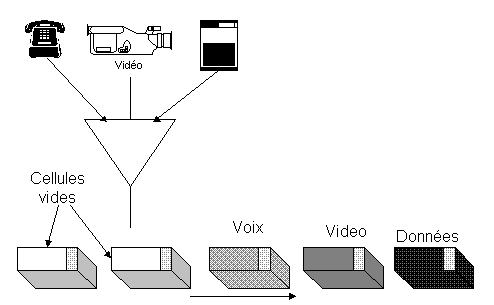
Afin
de préserver les exigences des différents flux (voix, vidéo,
données), ATM prévoit différentes classes de services,
qui font l’objet d’un contrat à la demande de connexion :
CBR : Constant Bit Rate, simule un circuit et permet de transférer de la voix non compressée.
VBR : Variable Bit Rate, permet de transporter des applications générant un flux irrégulier, VBR-RT (Real Time) s’applique aux flux nécessitant des contraintes temporelles alors que VBR-NRT n’apporte pas cette garantie.
ABR : Availlable Bit Rate, pas de garantie de débit mais apporte des informations sur l’état de charge du réseau permettant à l’émetteur de moduler son trafic.
UBR
: Unknown Bit Rate, pas de garantie de débit.
2.1 Pourquoi
48 octets ?
Le chiffre de 48 octets est un compromis entre les européens qui souhaitaient 32 octets et les américains qui en souhaitaient 64.
En effet l'information la plus difficile à prendre en compte est la parole. Techniquement, à l'émission un codeur/décodeur transforme un signal analogique en numérique à raison d'un octet toutes les 125 µs (la parole nécessite une bande passante de 4000 Hz, le théorème de Shannon impose une fréquence de 8000 Hz soit une période de 125 µs). A la réception un équipement identique réalise l'opération en sens inverse.
Pour remplir la cellule de 48 octets à raison d'un octet toutes les 125 µs, il faut environ 6 ms soit au total 12 ms pour remplir et vider la cellule. Pour le temps de transfert de la parole une norme CCITT recommande une valeur inférieure à 28 ms, en prenant 12 ms pour la conversion analogique/numérique, il ne reste plus que 16 ms pour le transport. Sur un support métallique comme le cuivre ceci correspond à une distance de 3200 km (à 200 000 km/s). Au delà les communications subissent un certain nombre de dégradations (distorsions, echo).
Les européens souhaitaient 32 octets pour disposer d'un temps de propagation plus grand car les pays étant petits (inférieur à 3000 km) , ils ne sont pas équipés d'infrastructure pour , par exemple, supprimer les échos.
Les
américains en revanche auraient préféré 64
octets afin d'être moins pénalisés par les 5 octets
d'en-tête. Le temps de propagation ayant une moindre importance aux
USA car le pays est immense et il est déjà équipé
de matériels pour prendre en compte tous les phénomènes
d'échos et autres.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 La
couche physique
ATM appartenant à la couche 2 du modèle de référence OSI il est donc indépendant du support de transmission mais est pleinement efficace sur les réseaux de fibres optiques. Au niveau de la couche physique, il est nécessaire d'utiliser un protocole qui décrit précisément comment les cellules vont être émises sur le médium. Plusieurs solutions sont envisageables. La plus couramment utilisée se nomme SONET (Synchronous Optical Network) ou son équivalent en Europe SDH (Synchronous Digital Hierarchy) .
Le principe consiste à faire transiter en permanence, toutes les 125 µs, une trame (un bloc de paquets parfaitement défini et de longueur constante) entre deux nœuds de commutation. Schématiquement, ceci correspond à un train qui circule en permanence entre deux gares, une cellule ATM peut monter dans ce train à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit de ce train.
SONET est une recommandation de l’ANSI et a déjà été adoptée par la téléphonie américaine pour la gestion de ses réseaux et adaptée pour recevoir ATM. L’ITU (ex CCITT) a normalisé la hiérarchie SDH.
SONET
exploite aussi les différentes vitesses pour le support optique
:
OC-1(Optical Carrier) 51,84 Mbits/s
OC-3 155,52 Mbits/s (3 x 51,84)
OC-12
622,08 Mbits/s (12 x 51,84)
Ces vitesses ne sont limitées que par la technique des interfaces, on envisage déjà les vitesse
OC-24, 36 ou 48, soit 1,24, 1,86 et 2,5 Gbits/s.
La génération existante aujourd'hui (1993) est dite plésiochrone. La vitesse de base est de 2 Mbits/s (E1) suivie par des vitesses multiples de celle-ci soit 34 (E3) et 140 Mbits/s (E4). C'est l'offre actuelle (1993) de France Télécom et des autres PTT européennes.
Les
nouveaux matériels de transmission qui arrivent depuis peu (1993)
aux USA sont basés sur la technique SONET ou SDH avec des débits
de 155 Mbits/s puis 622 Mbits/s…
2.3 Perspectives
(Janvier 94)
Pour France Télécom l'introduction de produits SDH correspondent aux besoins du réseau de communication interurbain des grands commutateurs régionaux. Le réseau de distribution ne sera pas sous cette technique avant longtemps.
On prévoit d'installer une prise ATM dans les foyers vers 2010, mais cette technique intéresse surtout les opérateurs du câble pour le multimédia.
Cette technique s'applique aux interconnexions d'ordinateurs et également aux besoins vidéo. Cette dernière catégorie apparaît comme l'une de plus prometteuses car elle est déjà très demandée pour la visioconférence.
Actuellement (1994) Alcatel dispose déjà de "chips" ATM à 620 Mbits/s.
Le
RNIS se trouvant au niveau 3 profitera naturellement des améliorations
en vitesse qu'apportera ATM.
2.4 Déploiement
d'ATM
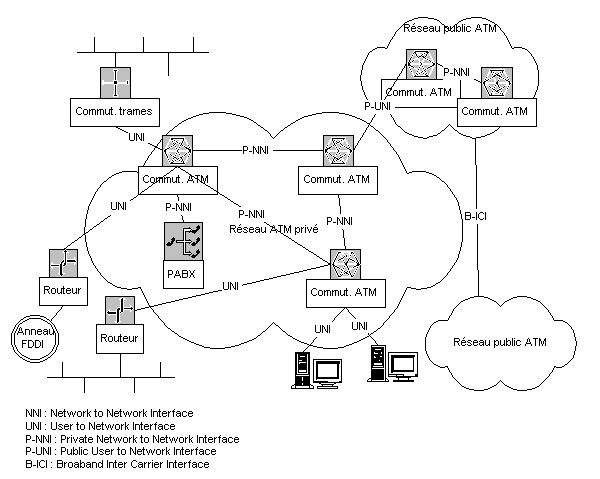 .
.
3. ATM et
les réseaux locaux existants.
Bien qu’ATM permette la connexion directe de stations de travail et de serveurs cela nécessite le changement des cartes d’interface et peut-être de la topologie du réseau. Pour préserver l’investissement fait dans les réseaux locaux (70 millions de noeuds Ethernet installés dans le monde) le forum ATM a défini un protocole d’émulation de réseaux locaux (LAN Emulation - LANE) dont “ Le principal objectif consiste à permettre aux applications existantes d’accéder à un réseau ATM via les piles de protocoles APPN, NetBIOS, IPx, etc ..., comme si elles s’exécutaient sur un réseau local traditionnel ”.
Il existe des différences fondamentales entre les réseaux locaux ATM et les réseaux locaux à support partagé (Ethernet, Token Ring, FDDI, ... ) :
· Les réseaux locaux classiques utilisent la diffusion générale (broadcast) alors qu’ATM ne permet que des connexions point à point ou point à multipoint.
· ATM étant vu par les applications comme un réseau de commutation “ réseau à plat ”, les broadcasts simulés sont envoyés à toutes les connexions (pas de limitation par domaine de broadcast).
· ATM supporte plusieurs qualités de service, les protocoles de réseau actuels n’en supportent pas, mais les nouveaux protocoles (IPV6) les supporteront, il faudra alors établir une correspondance avec les qualités de service disponibles sur ATM.
3.1 Lan
Emulation : LANE
Afin de protéger les investissements des utilisateurs au niveau des applications et des logiciels réseau, et pour rendre le support ATM utilisable par les protocoles existants, ATM va devoir se comporter comme un réseau local classique grâce à LANE.
Du
point de vue conceptuel LANE offre une couche de traduction entre les couches
hautes s’appuyant sur un service sans connexion et la couche basse ATM
qui nécessite l’établissement d’une connexion avant toute
communication.
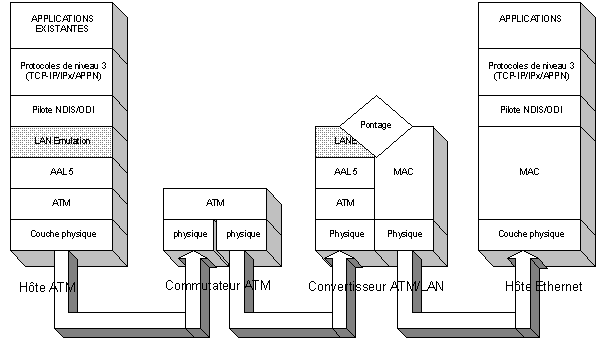
La couche ATM est directement au dessus de la couche physique, l’indépendance du support est un principe fondamental d’ATM. La couche ATM gère les en-têtes des cellules ATM qui sont de longueur fixe. Elle reçoit, des couches supérieures, les informations à mettre dans les cellules, elle ajoute l’en-tête et passe les cellules résultantes (53 octets) à la couche physique. En réception elle reçoit les cellules de la couche physique, extrait l’en-tête, et passe les 48 bits restants aux couches supérieures. La couche ATM n’a pas connaissance du type de trafic qu’elle transporte, cependant elle doit distinguer les qualités de service grâce aux informations acquises pendant la phase de connexion.
La couche d’adaptation ATM (ATM Adaptation Layer - AAL) découpe les données en “ morceaux ” de 48 bits afin de pouvoir les “ charger ” dans les cellules ( cette opération s’appelle la segmentation). Lorsque les cellules ATM atteignent leur destination, on reconstruit les données pour les couches supérieures, ce processus s’appelle réassemblage.
Comme ATM doit pouvoir transmettre différents types de trafic, il existe, au niveau de la couche adaptation, plusieurs protocoles, chacun travaillant simultanément. C’est l’AAL de type 5 qui est utilisée pour l’émulation de réseau local, LANE est donc au dessus de AAL5. Dans un convertisseur LAN/ATM, LANE résout les problèmes pour tous les protocoles (routables ou non routables) en traduisant les adresses LAN en adresses ATM au niveau de la couche MAC. LANE est totalement indépendant des protocoles des couches supérieures, des services et des applications.
LANE est entièrement transparent pour les réseaux ATM et pour les hôtes Ethernet ou Token Ring. LANE masque complètement l’établissement de la connexion et les fonctions de prise de contact (handshaking) nécessaires aux commutateurs ATM.
LANE
traduit les communications entre noeuds ayant une adresse MAC (réseaux
locaux classiques) en communications sur des circuits virtuels ATM. Le
réseau ATM apparaît alors comme un réseau sans connexion
(pour les couches supérieures).
3.1.1 Les composants
fonctionnels de LANE.
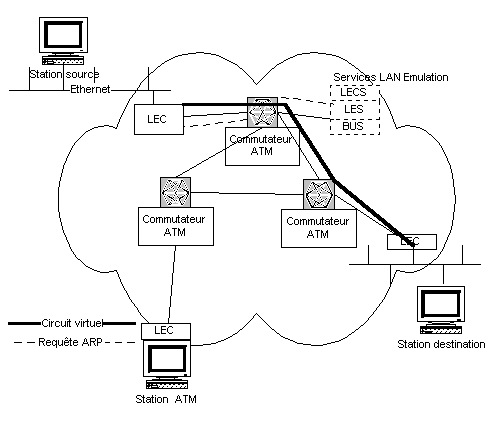
· Le LES contrôle le réseau et gère la traduction d’adresses MAC en adresses ATM.
· Le BUS est conçu pour transmettre les paquets de diffusion (broadcast) comme les paquets ARP de TCP/IP. Il gère également tout le trafic multi-destination (multicast). Pendant la phase transitoire il diffuse (broadcast) les premiers paquets adressés à une seule station (unicast) envoyés par le LEC (Lan Emulation Client) pendant que le LES cherche à obtenir l’adresse ATM de la station destinataire afin d’établir un circuit virtuel direct entre la source et la destination.
· Le LECS (Lan Emulation Configuration Serveur) doit affecter dynamiquement les différents LECs aux différents LAN émulés (ELAN). Il indique au client (LEC) l’adresse ATM du LES dont il dépend. Il peut affecter un LEC à un LAN émulé (ELAN) soit sur la base de sa position physique (adresse ATM du LEC) soit grâce à une association logique.
1. Des connexions de commande qui transportent des messages administratifs tels que les informations nécessaires à la configuration initiale ou les adresses des autres LECs.
2. Des connexions transportant les données de toutes les autres communications. Elles permettent, en particulier, les liaisons point à point entre clients et les liaisons entre clients et BUS pour les messages de diffusion générale et multipoints.
3.1.2 Les LANs
émulés.
Un client LANE obtient la traduction des adresses MAC en adresses ATM grâce aux fonctions du serveur. Chaque client est connecté à un serveur par une connexion virtuelle. Seuls les clients connectés au même serveur peuvent communiquer entre eux : ils appartiennent au même LAN émulé.
EXEMPLE
:
Vue
physique :
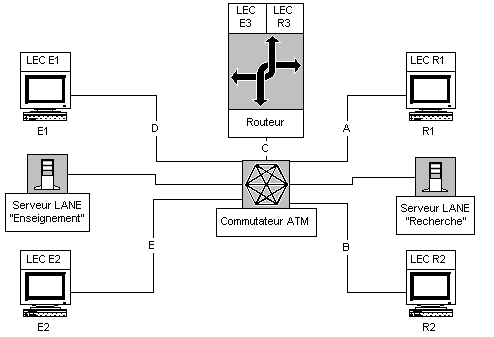
Base
de données du serveur “ enseignement ”
| Adresse MAC | Adresse ATM |
| E1 | D |
| E2 | E |
| E3 | C |
Base
de données du serveur “ recherche ”
| Adresse MAC | Adresse ATM |
| R1 | A |
| R2 | B |
| R3 | C |
Quand
le client “ recherche ” R1 veut envoyer un paquet au client “ enseignement
” E1, le serveur “ recherche ” cherche E1 dans sa base. Il ne le trouve
pas, alors il renvoie l’adresse du routeur E3/R3 qui à son tour
renvoie le paquet au serveur “ enseignement ” pour transmission à
E1 (le paquet traverse 2 fois le commutateur ATM).
Vue logique :
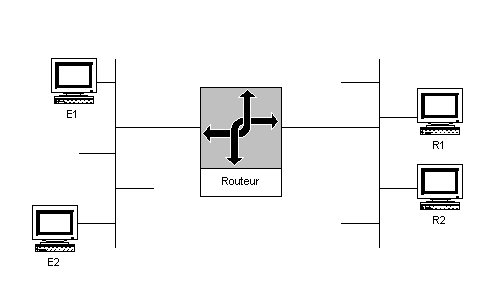
3.1.3 Exemple fonctionnel détaillé.
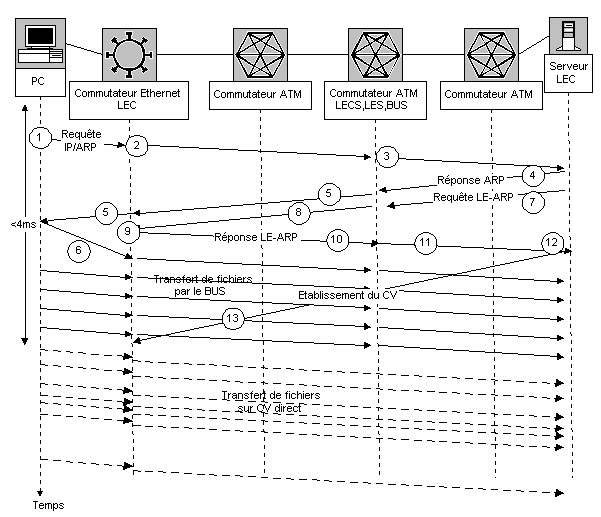
1. Le logiciel réseau du PC doit localiser le serveur. Pour déterminer l’adresse MAC du serveur le PC envoie une requête ARP (Address Resolution Protocol) en broadcast (Ethernet) contenant l’adresse IP du serveur avec lequel il veut communiquer (procédure classique sur les réseaux Ethernet/IP).
2. La requête ARP atteint le commutateur Ethernet/ATM, son LEC transmet ce paquet broadcast au BUS.
3. Le BUS envoie la requête ARP à tous les noeuds du LAN émulé sur un circuit virtuel point à multipoint (CV).
4. Le LEC du serveur reçoit la requête ARP et reconnaît sa propre adresse IP. En réponse il envoie son adresse MAC dans un paquet ARP vers l’adresse MAC du PC demandeur. Il n’y a pas encore de circuit virtuel vers le commutateur Ethernet/ATM sur lequel est connecté le PC, alors le LEC du serveur envoie la réponse ARP au BUS. Simultanément il commence a créer un circuit virtuel vers le commutateur Ethernet ATM (comme décrit à l’étape 7).
5. Le BUS retransmet (par simulation de broadcast) la réponse ARP au commutateur Ethernet/ATM, qui la transmet à son tour au PC.
6. Maintenant le PC connaît l’adresse MAC du serveur et peut commencer à échanger des paquets avec le serveur, pour cela il utilse les services du BUS.
7. Pendant ce temps le LEC du serveur crée un circuit virtuel direct vers le commutateur Ethernet/ATM : il commence par envoyer une requête LE-ARP au LES pour demander l’adresse ATM correspondant à l’adresse MAC du PC (l’adresse MAC du PC à été obtenue à partir de la requête ARP de l’étape 4).
8. Le LES ne peut pas trouver l’adresse MAC du PC dans sa table de référence car le PC est “ masqué ” par le commutateur Ethernet/ATM. Le LES va donc envoyer la requête LE-ARP en multicast à tous les LECs.
9. Le LEC du commutateur Ethernet/ATM reçoit la requête LE-ARP et reconnaît l’adresse MAC du PC (il a pris connaissance de l’adresse MAC du PC lorsqu’il a du gérer le broadcast ARP de l’étape 2).
10. Le LEC du commutateur Ethernet/ATM renvoie sa propre adresse ATM dans une réponse LE-ARP et la renvoie au LES.
11. Le LES renvoie par multicast la réponse LE-ARP à tous les membres du LAN émulé.
12. Le LEC du serveur reçoit la réponse LE-ARP, il extrait l’adresse ATM du commutateur Ethernet/ATM et demande l’établissement d’un circuit virtuel direct (CV) vers celui-ci.
13. La dorsale ATM établit un CV direct entre le serveur et le commutateur Ethernet/ATM.
14. Les échanges entre le serveur et le PC s’effectuent maintenant directement (CV).
Le modèle est restreint au transport du protocole IP et simplifie donc les procédures LAN Emulation qui ont une vocation multi protocole.
Classical IP est basé sur des sous-réseaux logiques IP (LIS - Logical IP Subnet) supportés par des circuits virtuels commutés (CVC). Un LIS est un ensemble de Noeuds IP connectés à un réseau ATM (ces noeuds appartiennent au même sous-réseau IP [subnet]).
Pour établir un CVC chaque station doit connaître l’adresse ATM du destinataire IP qu’elle cherche à joindre. L’obtention de cette adresse s’appuie sur un serveur désigné ATM-ARP (ATM Address Resolution Protocol) capable de traduire (en adresse ATM) les adresses des membres IP appartenant à un même LIS (on ne peut pas utiliser de broadcast ARP sur ATM). Tous les logiciels classical IP ont bien entendu en mémoire l’adresse ATM du serveur ATM-ARP dont ils relèvent. Les LIS portent la même adresse ATM que leur serveur.
A chaque connexion d’un circuit virtuel le serveur ATM-ARP met à jour sa table de correspondance en lançant vers le client une requête I-ATM-ARP (Inverse ATM-ARP) pour obtenir l’adresse IP (à partir d’une adresse ATM). L’adresse ATM est considérée comme une adresse matérielle au même titre que les adresses MAC (Ethernet). Lorsque les circuits virtuels sont établis le paquet IP est intégré à la PDU AAL5 CPCS (Common Part Convergence Sub-layer).
Comparé au service LANE, classical IP se révèle très économe en ressources mais il est monoprotocolaire. Classical IP ne prend pas en compte les critères de qualité de service (il utilise des connexions UBR ou ABR). D’autre part l’organisation en sous réseaux IP (LIS) impose de “ remonter ” au niveau 3 (routeur) pour passer d’un sous-réseau à un autre ce qui occasionne un goulot d’étranglement sur l’infrastructure ATM (les routeurs doivent posséder une interface ATM et le logiciel classical IP), le délai de transit devient alors proportionnel au nombre de LIS traversés. Pour éviter cet inconvénient l’IETF propose une solution appelée NHRP (Next Hop Resolution Protocol. Cette solution repose sur un serveur de routes appelé NHS (Next Hop Server) qui convertit les données de routage IP de l’émetteur en adresse ATM du destinataire, une fois cette conversion réalisée les datagrammes transitent directement sur un circuit virtuel ATM sans aucun traitement de routage intermédiaire.
NHRP présente des points faibles dans la prise en compte du trafic broadcast et multicast, là encore l’IETF propose une solution à l’aide du protocole MARS (Multicast Address Resolution Server).
Comparaison des modèles LAN Emulation et Classical IP :
3.3 Multi Protocol Over ATM (MPOA).
MPOA permet une connexion directe, à travers un réseau ATM, entre des noeuds ATM et/ou des noeuds classiques résidents sur des sous-réseaux (subnet) distincts.
La spécification MPOA a été approuvée en juillet 1997, elle vise à optimiser l’exploitation des circuits ATM (commutation) tout en conservant la fonction de routage multi-protocole.
MPOA s’inspire largement du protocole classical IP. Il utilise le routage “ zéro saut ” NHRP (Next Hop Resolution Protocol) et la gestion du trafic MARS (Multicast Address Resolution Server) de l’IETF. Il cohabite avec les protocoles de routage traditionnels comme RIP et OSPF.
L’architecture MPOA applique la commutation ATM à tous les protocoles de routage en diminuant notablement les temps de transit. Après avoir identifié le destinataire, l’émetteur établit un circuit virtuel d’une seule traite sans avoir à “ remonter ” au niveau 3 à chaque traversée de routeur pour obtenir la route suivante (MPOA supprime les “ sauts de puce ” imposés par les routages traditionnels.
MPOA autorise l’emploi de MTU (Maximum Transfer Unit) de taille variable pour optimiser le débit et prend en compte certains critères de qualité de service ATM.
L
‘architecture MPOA se base sur la notion de routeur virtuel, compromis
entre les routeurs traditionnels et les commutateurs de niveau 3. Le routeur
virtuel détermine le chemin optimal entre les réseaux
virtuels, on l’appelle, par abus de langage, serveur de routes. Le
routeur virtuel intègre les protocoles de routage traditionnels,
gère les trafics broadcast et multicast, il réalise les résolutions
d’adresses des commutateurs restées sans réponse. Ce routeur
virtuel a pour bus un ensemble de commutateurs ATM. Cette architecture
élimine le goulot d’étranglement introduit par les routeurs
classiques.
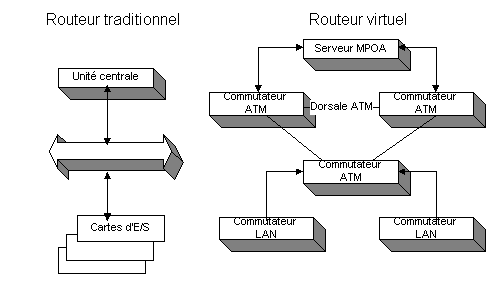
Dans la pratique cette architecture est réalisée par 2 unités logiques opérant en mode client/serveur :
· Unité d’accès MPOA (client): C’est une station ATM ou commutateur LAN de niveau 3 qui héberge un logiciel client MPOA, appelé MPC, inter-agissant avec un LEC (Lan Emulation Client) et/ou un gestionnaire de commutation de niveau 3. Cette unité est également appelée équipement d’extrémité (edge device) ou commutateur multiniveau (multi layer switch). Elle transmet les paquets entre les noeuds d’un réseau local et les noeuds ATM. Elle ne contient pas des protocole de routage, mais doit pouvoir commuter à diférents niveaux.
· Routeur MPOA (serveur) : Il est constitué d’un commutateur ATM associé à un logiciel serveur MPOA appelé MPS. Ce dernier, intégré au sein de l’équipement hôte ou opérant sur une station externe, comprend un serveur NHS (Next Hop Server) chargé de l’interconnexion avec les MPC. Le serveur MPOA dispose d’un moteur de routage conventionnel (RIP, OSPF, ...) et d’un serveur LES qui renseigne les LECSs sur l’adresse ATM des noeuds destinataires appartenant à un même réseau émulé. Le routeur MPOA doit avoir une connaissance des adresses MAC ainsi que des protocoles de la couche 3 (routage) du sous-réseau qu’il sert. Il doit également distribuer cette information à d’autres serveurs.
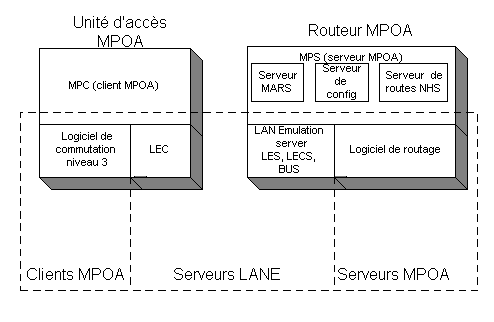
Lorsque le circuit virtuel est établi entre le demandeur et son destinataire, la transmission se résume à une simple opération de pontage. En revanche lorsque les correspondants dépendent de réseaux émulés (ELAN) distincts le LES passe la main au serveur MPOA qui joue alors le rôle d’intermédiaire.
Exemple de communication :
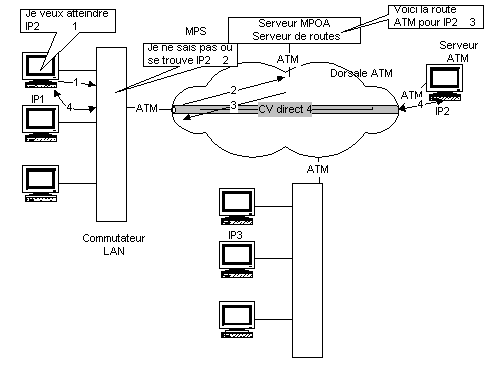
MPOA
fournit les services suivants :
n Type de protocole supporté.
n Appartenance aux ELAN
n Adresses ATM des clients MPOA.
-Transmission directe du trafic unicast vers le destinataire (procédure par défaut).
-Transmission
en utilisant les informations (concernant la couche réseau du destinataire)
déjà mémorisées.
Conclusion
:
Le modèle MPOA décrit un routeur distribué, les équipements d’extrémité (clients) assurent la commutation (retransmission) alors que le serveur de routes (serveur) établit les tables de routage et fournit les routes aux équipements d’extrémité.
Ce modèle permet aux équipements MPOA d’un sous-réseau (subnet) d’établir des connexions directes avec les équipements d’un autre sous-réseau. Cela permet les communications entre différents ELAN.
MPOA
assure l’évolutivité d’un réseau entièrement
routé tout en mettant la qualité de service à la disposition
des couches de niveau 3.
Le modèle MPOA :
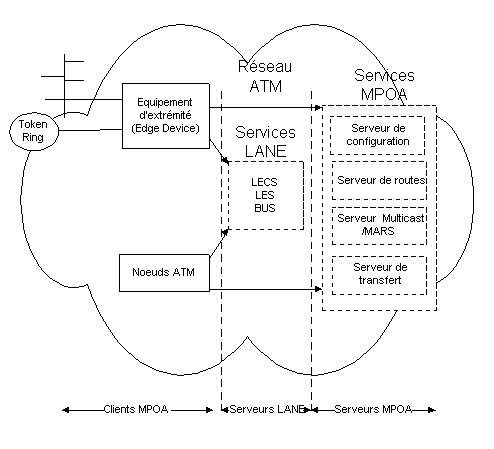
3.3.2 LAN Emulation
et MPOA.
Interactions
entre LANE et MPOA : les clients MPOA cherchent d’abord à résoudre
les adresses en utilisant les services LANE. En cas de nécessité
ils utilisent les services MPOA.
1. Communication entre 2 éléments reliés au même commutateur d’extrémité (A et B) : commutation Ethernet classique.
2. Communication intra ELAN (A et C) : Le serveur LAN Emulation (LES) de l’ELAN met en relation directe les 2 commutateurs par l’intermédiaire d’un circuit virtuel ATM (CV). Les 2 stations peuvent alors communiquer par LES interposé, comme dans un environnement Ethernet classique. En fin de communication le CV est détruit.
3. Communication inter ELAN (A et D) : Le LEC est incapable de mettre en relation les commutateurs (LEC) de 2 ELAN différents. Il établit alors, par défaut, une relation entre le commutateur de son ELAN (LEC) et le routeur. Le serveur MPOA du routeur (MPS) donne la route pour atteindre la destination et met en relation directe les 2 commutateurs d’extrémité (MPC/LEC) par l’intermédiaire d’un circuit virtuel ATM (CV). Les 2 stations communiquent par MPC interposé comme dans un environnement IP classique. En fin de communication le CV est détruit.